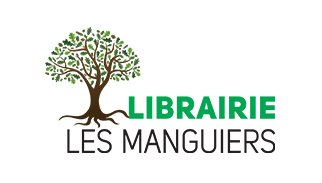Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fait du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
Loango-Brazzaville à piedJeudi 5 Février 2015 - 18:04 Au 19ème siècle, les villes de Pointe- Noire et Brazzaville étaient reliées par la route des caravanes dont l’itinéraire connut de fréquentes modifications. Inauguré en 1881 par le père Prosper Augouard, futur Monseigneur, elle est, pendant de nombreuses années, la seule voie de pénétration et de ravitaillement de Brazzaville. Ce n’était pas une sinécure. Pour la petite histoire, Mgr Augouard reçut des Vilis, le surnom de Diata Diata (De la vitesse). Loango était la tête de ligne de la route des caravanes. Le transport des marchandises se faisait à dos d’homme. Les porteurs étaient payés à prix d’or. Ils se recrutaient dans la population Loango. Pour les embaucher, l’explorateur ou le négociant s’adressait à de petits chefs de caravanes, auxquels on donnait le nom de capites, nom qui a donné capita, une acclimatation locale. Ils étaient chargés de fournir un certain nombre d’hommes et recevaient, pour ce faire, une avance considérable. La caravane touchait alors un tiers du total de paiement et une indemnité pour les vivres. Sept mille hommes, d’autres sources parlent de quinze mille, accomplissaient annuellement le parcours. Loango était, à l’époque, un poste très actif. L’administration coloniale n’y plaçait que des agents qui avaient fait leurs preuves, tels Cholet et Fourneau, collaborateurs de Pierre Savorgnan de Brazza. « Les porteurs étaient payés en marchandises évaluées à partir d’une unité de mesure qui avait une valeur fictive d’un franc et en bouteilles. […] Une fois inscrits et payés, les porteurs se répartissaient les « charges », colis de 30 kilos environ. Des caisses et des ballots en nombre égal à celui des hommes étaient disposés devant les porteurs et, à un signal donné, ceux-ci se précipitaient sur les charges. Au cours de la mêlée qui s’ensuivait, les plus robustes s’efforçaient naturellement de s’emparer les moins lourds. Les paquets les plus pesants restaient aux malingres. Les porteurs plaçaient ensuite les charges dans des sortes de longs paniers appelés moutète et formés de deux grandes feuilles de palmier à huile. Le moutète sur l’épaule ou plus souvent sur la tête, la caravane se mettait en route. » Le parcours entre Pointe-Noire et Brazzaville n’était pas toujours aisé. Outre les difficultés de ravitaillement, « il arrivait aussi que le voyage ne fut pas sûr. Vers 1893-94, un chef de brigands nommé Mafouque Dendé, coupa la route. Il fallut, pour le réduire, une expédition de 116 miliciens conduits par Veistroffer. […] Tous les ans, au commencement de la saison sèche, une épidémie de variole se déclenchait à Loango et interrompait le trafic. La construction du chemin de fer belge de Matadi à Kinshasa devait, en 1898, fermer définitivement cette route. Désormais tout le trafic emprunta la route du Congo-belge et quelques rares convois circulèrent encore sur la route Loango-Brazzaville. » Alors qu’il faillait de 25 à 30 jours pour rallier Brazzaville au départ de Pointe-Noire par la fameuse route des caravanes, au stade actuel d’avancement des travaux de la route Pointe-Noire-Brazzaville, une journée à peine suffit. D’ici quelques mois, quelques heures suffiront pour couvrir les quelque 550 km qui séparent ces deux grandes villes du pays. On ne peut donc que mieux apprécier les efforts de construction des routes impulsés par le président Denis Sassou N’Guesso. Le maillage actuel est un atout incontestable pour le développement de l’hinterland longtemps coupé des grands centres de décision. Les aéroports, construits sur toute l’étendue de la République, facilitent désormais les échanges des biens et des personnes. L’avion a aujourd’hui supplanté le train dans le transport des passagers. Le Chemin de fer Congo-Océan (Cfco), en dépit de son obsolescence, continue encore de rendre d’immenses services. Sa modernisation devrait être la prochaine bataille pour qu’elle contribue davantage au transport des personnes et du fret. Dans tous les cas, les progrès accomplis dans le domaine des communications sont remarquables et incontestables. Mfumu Edition:Édition Quotidienne (DB) |