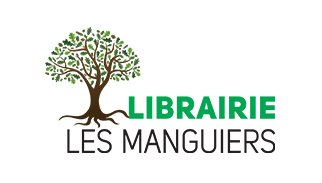Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fait du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
L’Assemblée nationale en 1961Vendredi 9 Mai 2014 - 0:11 Le 9 mai 1961, Marcel Ibalico remplace Alphonse Massamba-Débat en qualité de président de l’Assemblée nationale, une assemblée monocamérale. Le nouveau président de l’Assemblée est un homme de culture, spécialiste de la civilisation téké. L’Assemblée nationale congolaise comprend 58 membres : Abouri Raymond, Bankaites J.-R., Bazinga Apollinaire, Biyoudi Jean, Boungou Lazare, Fourvelle Albert, Gandzion Prosper, Goma Étienne, Gouama Abraham, Goura Pierre, Ibalico Marcel, Ibouanga Isaac, Kibangou Michel, Kimbouala François, Kinanga Rigobert, Kinkosso Jean-Baptiste, Kouka Alphonse, Koumbou Gérard, Leko Marie-Joseph, Lheyet-Gaboka M., Lifou Frédéric, Locko Prosper, Mpara René, Mafouana Jean-Pierre, Makita Paul, Malanda Laurent, Mambéké-Boucher B., Mampassi Célestin, Mapingou Basile, Massamba-Débat Alphonse, Mavioka Hilaire, Menga Mathurin, Milongo Gaston, Mouanda Marcel, Mouandza Jean-Ch., Mougany Édouard, Moungala Rubens, Ndéko Raphaël, Nguenoni Louis, Nkanza Jean, Obongui Gabriel, Okomba Faustin, Okouéré Omer, Oniangué Martin, Opangault Jacques, Portella André, Safou Hubert, Samba Germain, Sathoud Victor, Senso Joseph, Sita Jean-Baptiste, Tamphila Étienne, Taty Raphaël, Tchitchelle, Teckessé Pierre, Vouka Samuel, Yambot Georges, Youlou Fulbert. La première impression qui se dégage à la lecture de la composition de l’Assemblée est son machisme évident. Aucune femme à l’appel. La seconde est la présence dans cette instance du président de la République, de son vice-président et des ministres. On peut aussi observer, outre les membres du gouvernement, des personnalités fortes comme Maurice Lheyet-Gaboka, véritable tribun qui enflammait l’hémicycle par ses envolées lyriques et acrimonieuses ; et Portella André, qui donna son nom à une loi sur la protection de la jeunesse dont l’efficacité, grâce à une application rigoureuse par les forces de police, contribua à discipliner cette jeunesse. Yambot Georges, entré dans l’histoire par son basculement du côté de l’abbé Youlou Fulbert, qui, par sa défection, permit à ce dernier de battre Opangault Jacques. En dépit de quelques couacs dans leurs relations, Youlou et Opangault, au nom de l’union sacrée, firent de leur mieux pour éviter au pays de basculer dans la guerre, excepté l’épisode sanglant de février 1959, vite circonscrit par un appel au calme des deux leaders. C’était une autre époque où la solidarité, en politique, n’était pas un vain mot. Opangault, approché pour intégrer la nouvelle équipe dirigeante après la révolution des 13, 14 et 15 août 1963, préféra rejoindre Youlou en prison. Relaxé, il tourna définitivement le dos à la politique malgré les appels répétés des dirigeants qui se succédèrent au pouvoir jusqu’en 1968. L’intérêt supérieur de la nation était, alors, le fil conducteur de l’action politique. Ce qui, à l’évidence, n’est plus le cas aujourd’hui, où les protagonistes, la susceptibilité à fleur de peau, sont prêts à en découdre pour des calembredaines. Depuis quelque temps, nous sommes entrés dans un épisode chicanier. Au centre des contradictions, la Constitution de 2002. La conserver ou la changer, telle est la controverse actuelle. Certains, qui hier, la soutenaient s’y opposent désormais ; d’autres, qui la vouaient aux gémonies, en deviennent de fervents défenseurs. Certes il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, mais ce type de changement relève davantage de l’inconsistance des engagements et de la volte-face acrobatique qui ressemble au calcul politicien. Il faut sortir de ces postures déshonorantes pour que 2016 soit le début d’une nouvelle république plus éthique, plus solidaire, plus équitable et plus juste. Mais cette émergence républicaine ne peut se faire sans une refonte des structures et des institutions. Se doter d’un nouveau texte constitutionnel, consensuel, impersonnel et pertinent est le premier chantier qui devrait nous sortir définitivement des chicaneries d’une insondable superficialité qui plombent notre vivre ensemble. Il y a de bonnes raisons de changer la Constitution de janvier 2002. Mfumu Edition:Édition Quotidienne (DB) |