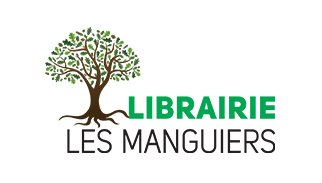Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fait du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
La parenté africaine a horreur de certains termes !Lundi 2 Juin 2014 - 0:34 Ces termes sont nombreux dans le jargon familial et parental. Et si l’usage de ceux-ci est aisé dans le système parental occidental, en revanche l’usage abusif de ces termes en Afrique frustre de nombreux membres de la famille consanguine, voire sociale du père ou de la mère biologiques. Dans un quartier d’une sous-préfecture où se tenait une cérémonie de dot, le frère aîné du père biologique de la fille à doter allait refuser symboliquement de boire le vin parce que la fille l’avait qualifié d’oncle paternel alors qu’il revendiquait être le père car parlant en lieu et place de son jeune frère qui n’était plus de ce monde. La tension a pu être apaisée par le côté maternel de la fille qui reconnut le glissement de langage de la fille, et la chose a été réparée de justesse. Ces notions que sont tante maternelle, oncle paternel, cousin ou cousin germain, demi-frère, neveu, demi-sœur et autres, génèrent au sein des familles des divisions et des séparations inexplicables. Car pour de nombreuses familles, ces notions, au lieu de resserrer les liens du sang entre les parents, créent des rejets familiaux entre les personnes de même père ou de même mère. Certains parents, ayant mesuré la dangerosité de la chose, commencent à conseiller à leurs enfants d’utiliser ces termes avec philosophie. Le langage serré coutumier en matière de parenté africaine en général et congolaise en particulier admet que ces termes ont tous une signification évasive teintée d’exclusion. On appelle oncle et tante dans de nombreux départements et sous-préfectures du pays respectivement le frère de la maman et la sœur du papa, étant donné que tous les frères du père sont dénommés pères et toutes les sœurs de maman sont appelées mères, le contraire reviendrait à les éloigner du père biologique. Du coup, tous les enfants s’appellent entre eux frères et sœurs, car les termes demi-frère, cousin et demi-sœur sont trop restrictifs, en ce sens que de nombreuses familles estiment que la demi-consanguinité n’existe pas. Un frère né d’un même père, mais d’une mère différente est ni plus ni moins un frère à part entière, et le qualificatif « demi » est socialement parlant dévalorisant et péjoratif. De même, une tante maternelle qui vit avec la fille de sa petite sœur la réprimande lorsqu’elle entend sortir de sa bouche le terme de tante maternelle, voulant la distinguer par rapport à sa mère biologique. « Ma fille, tu dois cesser d’utiliser cette appellation. Je suis ta mère et non ta tante maternelle, j’ai le même sang que ta mère. Pourquoi m’écartes-tu de ta mère ? », sont les remontrances d’une sœur aînée à la fille de sa petite sœur, laissant cette dernière perplexe. Pour de nombreuses familles africaines, la réalité est donc bien visible, de même dans la plupart des familles congolaises. Le terme de tante est conçu par rapport au père, et le terme oncle par rapport à la mère. Et lorsqu’on dit tante, il s’agit de la sœur du père ; et l’oncle est le frère de la mère. Oui, le copié-collé anthropologique de la terminologie occidentale sur la réalité parentale africaine crée de nombreuses frustrations silencieuses, mais perceptibles au niveau de certaines familles. Car ces frustrations s’observent souvent au grand jour lors des cérémonies de dot, des concertations et des conseils familiaux. Vouloir superposer aux termes tantes et oncles des adjectifs maternels ou paternels semble donc illogique dans la réalité anthropolinguistique africaine, étant donné que la ruralité en termes de socialité, c’est-à-dire la manière de vivre liée à la coutume, n’est pas totalement supprimée dans nos villages, sous-préfectures, voire dans nos villes. On ne peut rejeter brutalement cette sagesse africaine qui veut qu’une personne ait pour pères à la fois celui qui lui a donné la vie biologiquement et tout le reste du lignage fait des frères et cousins de ce dernier, et pour mères à la fois celle qui a enfanté l’enfant et toutes ses sœurs et cousines. Cela apaisera nombre de tensions familiales. Il est quand même « congolaisement » méchant de voir rejeter le cadet de son père qui n’est pas son père, mais plutôt son oncle paternel. Ce rejet familial peut être pris avec des pincements au cœur. La conception du jargon parental africain n’est décidément pas facile à cerner dans le système occidental. Faustin Akono Edition:Édition Quotidienne (DB) |