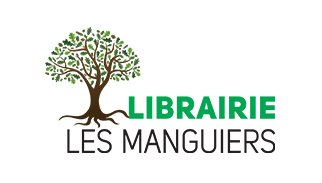Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fait du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
Et pourtant la culture du « Mbongui » sans calculs a ses atouts !Lundi 29 Décembre 2014 - 9:15 Le Mbongui dont il est fait allusion, ici, n’est pas un palais à l’occidentale où tous les longs discours et même ceux qui sortent de l’ordre du jour sont permis, il s’agit plutôt d’une institution sociale à l’africaine, d’où sortent des solutions justes et quelle que soit l’affaire traitée. Ce « Mbongui » se situait au centre du village, et surtout de la case du chef. Vrai lieu de concertation sociale, de sagesse, de pondération, de synergie sociale, de symbiose, de mixage social, en vue d’une socialisation acceptable par tous. Après le « Mbongui », en réalité, toute contestation devrait être éloignée du vécu quotidien. À dire vrai, il n’est ni le lieu de l’invective, de la calomnie, de l’insulte, du mensonge, de la trahison, de la revanche. Il ne traite pas de tous les problèmes mais plutôt du problème dont il est question et qui est soumis au chef pour appréciation. C’est ainsi qu’au village, un habitant qui perdait son filet dans la forêt, ou dans la rivière, trouvait en ce Mbongui un espace pour la résolution de son problème. Ici, les participants se concentraient sur le problème soumis à l’ordre du jour. Il aussi s’agir des questions d’intérêt communautaire. Par exemple, comment accroître le rendement agricole ? Il y a donc là, l’idée de la définition et de la circonscription du sujet à débattre au Mbongui. Cette survivance sociale africaine refait surface dans plusieurs pays africains, lorsqu’il y a certaines questions d’intérêt majeur. Tenez ! Dans de nombreux départements du pays, là où parfois la logique juridictionnelle et judiciaire moderne échoue, le Mbongui peut réussir en proposant des pistes de solutions. Tout dépendra donc du problème. Alors, pourquoi abandonnons-nous cette logique « mbonguiste » ? Que l’on veuille ou pas, les pays africains sont appelés à avoir une identité hybride, c’est-à-dire 50% d’occidental et 50% d’africain. Ainsi, les mécanismes de résolution de certains différends à travers le mbongui ne sont pas à rejeter. Il faut plutôt les entretenir et les enrichir. Plusieurs penseurs et intellectuels africains l’ont déjà maintes fois affirmé, le Mbongui est un carrefour ; il a ses atouts et ses avantages. Et lorsqu’on tire trop sur la fibre occidentale sans laisser une marge aux implications « mbonguistes » dans la recherche des solutions aux problèmes des sociétés africaines, cela s’apparente à du copier-coller. Une méthode rarement heureuse car elle n’est pas sans risques à court, moyen ou long terme. Le vrai problème, c’est de ne pas créer au sein du Mbongui des digressions qui, somme toute, faussent le règlement des problèmes. Les pays africains, quelle que soit leur spécificité culturelle, ont un soubassement sociologique commun lorsqu’il s’agit de traiter d’une question d’intérêt social avéré. De nombreux témoignages soutiennent le « Retour au Mbongui ». On citera l’Algérien Mahi Seddik et le Congolais Jorus Mabiala dont le spectacle était présenté au mois de juin de cette année à Pointe-Noire. La culture du Mbongui s’impose à nous. La rejeter, c’est nier l’une des valeurs cardinales de notre continent, car elle est une solution à de nombreux problèmes sociaux qui peuvent entraver la bonne marche d’un pays.
Faustin Akono Edition:Édition Quotidienne (DB) |